Ce fut une bataille homérique, couverte heure par heure par tous les médias du monde. L’Organisation de l’Etat islamique (OEI), qui avait conquis Mossoul en juin 2014, poursuivait son avancée fulgurante aussi bien vers Bagdad que vers la frontière turque ; elle occupait 80 % de la ville de Kobané, en Syrie. Les combats firent rage pendant plusieurs mois. Les miliciens kurdes locaux appuyés par l’aviation américaine reçurent des armes et le soutien de quelque cent cinquante soldats envoyés par le gouvernement régional du Kurdistan d’Irak. Suivis avec passion par les télévisions occidentales, les affrontements se terminèrent début 2015 par un repli de l’OEI.
 Le numéro actuellement en kiosques de « Manière de voir » décrypte les significations politiques du terrorisme. Après avoir évoqué les attentats de Paris et la dérive djihadiste, les articles analysent le phénomène dans ses contradictions (actions d’extrême droite et d’extrême gauche, séparatisme, terreur d’Etat…) en s’attachant aux réflexions de penseurs contemporains (Jacques Derrida, Noam Chomsky, Giorgio Agamben, etc.). Documents graphiques, extraits littéraires et cartographie inédite donnent au lecteur des outils pour mieux comprendre.
Le numéro actuellement en kiosques de « Manière de voir » décrypte les significations politiques du terrorisme. Après avoir évoqué les attentats de Paris et la dérive djihadiste, les articles analysent le phénomène dans ses contradictions (actions d’extrême droite et d’extrême gauche, séparatisme, terreur d’Etat…) en s’attachant aux réflexions de penseurs contemporains (Jacques Derrida, Noam Chomsky, Giorgio Agamben, etc.). Documents graphiques, extraits littéraires et cartographie inédite donnent au lecteur des outils pour mieux comprendre.
Mais qui sont ces héroïques résistants qui ont coupé une des têtes de l’hydre terroriste ? Qualifiés de manière générique de « Kurdes », ils appartiennent pour la plupart au Parti de l’union démocratique (PYD), la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Or le PKK figure depuis plus d’une décennie sur la liste des organisations terroristes dressée aussi bien par les Etats-Unis que par l’Union européenne. Ainsi, on peut être condamné à Paris pour « apologie du terrorisme » si l’on émet une opinion favorable au PKK ; mais à Kobané, leurs militants méritent toute notre admiration. Qui s’en étonnerait à l’heure où Washington et Téhéran négocient un accord historique sur le nucléaire et où le directeur du renseignement national américain transmet au Sénat un rapport dans lequel l’Iran et le Hezbollah ne sont plus désignés comme des entités terroristes qui menacent les intérêts des Etats-Unis (1) ?
Ce fut un été particulièrement agité. A Haïfa, un homme déposa une bombe sur un marché le 6 juillet ; vingt-trois personnes furent tuées et soixante-quinze blessées, en majorité des femmes et des enfants. Le 15, une attaque perpétrée à Jérusalem tua dix personnes et fit vingt-neuf blessés. Dix jours plus tard, une bombe explosa, toujours à Haïfa, faisant trente-neuf morts. Les victimes étaient toutes des civils et des Arabes. Dans la Palestine de 1938, ces actes furent revendiqués par l’Irgoun, bras armé de l’aile « révisionniste » du mouvement sioniste, qui donna à Israël deux premiers ministres : Menahem Begin et Itzhak Shamir (2).
Un concept flou
Résistants ? Combattants de la liberté ? Délinquants ? Barbares ? On sait que le qualificatif de « terroriste » est toujours appliqué à l’Autre, jamais à « nos combattants ». L’histoire nous a aussi appris que les terroristes d’hier peuvent devenir les dirigeants de demain. Est-ce étonnant ? Le terrorisme peut être défini — et les exemples du PKK et des groupes sionistes armés illustrent les ambiguïtés du concept — comme une forme d’action, pas comme une idéologie. Rien ne relie les groupes d’extrême droite italiens des années 1970, les Tigres tamouls et l’Armée républicaine irlandaise (Irish Republican Army, IRA), sans parler de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et du Congrès national africain (African National Congress, ANC), ces deux derniers dénoncés comme « terroristes » par Ronald Reagan, par Margaret Thatcher et, bien sûr, par M. Benyamin Netanyahou, dont le pays collaborait étroitement avec l’Afrique du Sud de l’apartheid (3).
Au mieux, on peut inscrire le terrorisme dans la liste des moyens militaires. Et, comme on l’a dit souvent, il est l’arme des faibles. Figure brillante de la révolution algérienne, arrêté par l’armée française en 1957, Larbi Ben Mhidi, chef de la région autonome d’Alger, fut interrogé sur la raison pour laquelle le Front de libération nationale (FLN) déposait des bombes camouflées au fond de couffins dans les cafés ou dans les lieux publics. « Donnez-nous vos avions, nous vous donnerons nos couffins », rétorqua-t-il à ses tortionnaires, qui allaient l’assassiner froidement quelques jours plus tard. La disproportion des moyens entre une guérilla et une armée régulière entraîne une disproportion du nombre des victimes. Si le Hamas et ses alliés doivent être considérés comme des « terroristes » pour avoir tué trois civils pendant la guerre de Gaza de l’été 2014, comment faut-il qualifier l’Etat d’Israël, qui en a massacré, selon les estimations les plus basses — celles de l’armée israélienne elle-même —, entre huit cents et mille, dont plusieurs centaines d’enfants ?
Au-delà de son caractère flou et indécis, l’usage du concept de terrorisme tend à dépolitiser les analyses et par là-même à rendre impossible toute compréhension des problèmes soulevés. Nous luttons contre l’« empire du Mal », affirmait le président George W. Bush devant le Congrès américain le 24 septembre 2001, ajoutant : « Ils haïssent ce qu’ils voient dans cette assemblée, un gouvernement démocratiquement élu. Leurs dirigeants se désignent eux-mêmes. Ils haïssent nos libertés : notre liberté religieuse, notre liberté de parole, notre liberté de voter et de nous réunir, d’être en désaccord les uns avec les autres. » Pour affronter le terrorisme, il n’est donc pas nécessaire de modifier les politiques américaines de guerre dans la région, de mettre un terme au calvaire des Palestiniens ; la seule solution tient à l’élimination physique du « barbare ». Si les frères Kouachi et Amedy Coulibaly, auteurs des attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes, sont mus fondamentalement par leur haine de la liberté d’expression, comme l’ont proclamé les principaux responsables politiques français, il est inutile de s’interroger sur les conséquences des politiques menées en Libye, au Mali et dans le Sahel. Le jour où l’Assemblée nationale rendait hommage aux victimes des attentats de janvier, elle votait d’un même élan la poursuite des opérations militaires françaises en Irak.
N’est-il pas temps de dresser le bilan de cette « guerre contre le terrorisme » en cours depuis 2001, du point de vue de ses objectifs affichés ? Selon le Global Terrorism Database de l’université du Maryland, Al-Qaida et ses filiales ont commis environ deux cents attentats par an entre 2007 et 2010. Ce nombre a augmenté de 300 % en 2013, avec six cents actes. Et nul doute que les chiffres de 2014 battront tous les records, avec la création du califat par M. Abou Bakr Al-Baghdadi (4). Qu’en est-il du nombre de terroristes ? Selon les estimations occidentales, vingt mille combattants étrangers ont rejoint l’OEI et les organisations extrémistes en Irak et en Syrie, dont trois mille quatre cents Européens. « Nick Rasmussen, le chef du Centre national de contre-terrorisme américain, a affirmé que le flot de combattants étrangers se rendant en Syrie dépasse de loin celui de ceux qui sont partis faire le djihad en Afghanistan, Pakistan, Irak, Yémen ou Somalie à un moment quelconque au cours de ces vingt dernières années (5). »
Ce bilan de la « guerre contre le terrorisme » serait bien fragmentaire s’il ne prenait en compte les désastres géopolitiques et humains. Depuis 2001, les Etats-Unis, parfois avec l’aide de leurs alliés, ont mené des guerres en Afghanistan, en Irak, en Libye et, de manière indirecte, au Pakistan, au Yémen et en Somalie. Bilan : l’Etat libyen a disparu, l’Etat irakien sombre dans le confessionnalisme et la guerre civile, le pouvoir afghan vacille, les talibans n’ont jamais été aussi puissants au Pakistan. Mme Condoleezza Rice, ancienne secrétaire d’Etat américaine, évoquait un « chaos constructif » en 2005 pour justifier la politique de l’administration Bush dans la région, annonçant des lendemains qui chanteraient l’hymne de la démocratie. Dix ans plus tard, le chaos s’est étendu à tout ce que les Etats-Unis appellent le « Grand Moyen-Orient », du Pakistan au Sahel. Et les populations ont été les premières victimes de cette utopie dont on a du mal à mesurer ce qu’elle a de constructif.
Des dizaines de milliers de civils ont été victimes des « bombardements ciblés », des drones, des commandos spéciaux, des arrestations arbitraires, des tortures sous l’égide de conseillers de la Central Intelligence Agency (CIA). Rien n’a été épargné, ni fêtes de mariage, ni cérémonies de naissance, ni funérailles, réduites en cendres par des tirs américains « ciblés ». Le journaliste Tom Engelhardt a relevé huit noces bombardées en Afghanistan, en Irak et au Yémen entre 2001 et 2013 (6). Quand elles sont évoquées en Occident, ce qui est rare, ces victimes, contrairement à celles que fait le « terrorisme », n’ont jamais de visage, jamais d’identité ; elles sont anonymes, « collatérales ». Pourtant, chacune a une famille, des frères et des sœurs, des parents. Faut-il s’étonner que leur souvenir alimente une haine grandissante contre les Etats-Unis et l’Occident ? Peut-on envisager que l’ancien président Bush soit traîné devant la Cour pénale internationale pour avoir envahi et détruit l’Irak ? Ces crimes jamais poursuivis confortent le crédit des discours les plus extrémistes dans la région.
En désignant l’ennemi comme une « menace existentielle », en le réduisant à l’« islamo-fascisme » comme l’a fait le premier ministre Manuel Valls, en évoquant une troisième guerre mondiale contre un nouveau totalitarisme héritier du fascisme et du communisme, l’Occident accorde à Al-Qaida et à l’OEI une visibilité, une notoriété, une stature comparable à celle de l’URSS, voire de l’Allemagne nazie. Il accroît artificiellement leur prestige et l’attraction qu’ils exercent sur ceux qui souhaitent résister à l’ordre imposé par des armées étrangères.
Certains dirigeants américains ont parfois des éclairs de lucidité. En octobre 2014, le secrétaire d’Etat John Kerry, célébrant avec les musulmans américains la « fête du sacrifice », déclarait en évoquant ses voyages dans la région et ses discussions concernant l’OEI :« Tous les dirigeants ont mentionné spontanément la nécessité d’essayer d’aboutir à la paix entre Israël et les Palestiniens, parce que [l’absence de paix] favorisait le recrutement [de l’OEI], la colère et les manifestations de la rue auxquels ces dirigeants devaient répondre. Il faut comprendre cette connexion avec l’humiliation et la perte de dignité (7). »
Il y aurait donc un rapport entre « terrorisme » et Palestine ? Entre la destruction de l’Irak et la poussée de l’OEI ? Entre les assassinats « ciblés » et la haine contre l’Occident ? Entre l’attentat du Bardo à Tunis, le démantèlement de la Libye et la misère des régions abandonnées de la Tunisie dont on espère, sans trop y croire, qu’elle recevra enfin une aide économique substantielle qui ne sera pas conditionnée aux recettes habituelles du Fonds monétaire international (FMI), créatrices d’injustices et de révoltes ?
Infléchir les politiques occidentales
Ancien de la CIA, excellent spécialiste de l’islam, Graham Fuller vient de publier un livre, A World Without Islam (« Un monde sans islam ») (8), dont il résume lui-même la conclusion principale :« Même s’il n’y avait pas eu une religion appelée islam ou un prophète nommé Mohammed, l’état des relations entre l’Occident et le Proche-Orient aujourd’hui serait plus ou moins inchangé. Cela peut paraître contre-intuitif, mais met en lumière un point essentiel : il existe une douzaine de bonnes raisons en dehors de l’islam et de la religion pour lesquelles les relations entre l’Occident et le Proche-Orient sont mauvaises (...) : les croisades (une aventure économique, sociale et géopolitique occidentale), l’impérialisme, le colonialisme, le contrôle occidental des ressources du Proche-Orient en énergie, la mise en place de dictatures pro-occidentales, les interventions politiques et militaires occidentales sans fin, les frontières redessinées, la création par l’Occident de l’Etat d’Israël, les invasions et les guerres américaines, les politiques américaines biaisées et persistantes à l’égard de la question palestinienne, etc. Rien de tout cela n’a de rapport avec l’islam. Il est vrai que les réactions de la région sont de plus en plus formulées en termes religieux et culturels, c’est-à-dire musulmans ou islamiques. Ce n’est pas surprenant. Dans chaque grand affrontement, on cherche à défendre sa cause dans les termes moraux les plus élevés. C’est ce qu’ont fait aussi bien les croisés chrétiens que le communisme avec sa “lutte pour le prolétariat international” (9). »
Même s’il faut s’inquiéter des discours de haine propagés par certains prêcheurs musulmans radicaux, la réforme de l’islam relève de la responsabilité des croyants. En revanche, l’inflexion des politiques occidentales qui, depuis des décennies, alimentent chaos et haines nous incombe. Et dédaignons les conseils de tous ces experts de la « guerre contre le terrorisme ». Le plus écouté à Washington depuis trente ans n’est autre que M. Netanyahou, le premier ministre israélien, dont le livre Terrorism : How the West Can Win (10) prétend expliquer comment on peut en finir avec le terrorisme ; il sert de bréviaire à tous les nouveaux croisés. Ses recettes ont alimenté la « guerre de civilisation » et plongé la région dans un chaos dont tout indique qu’elle aura du mal à sortir.










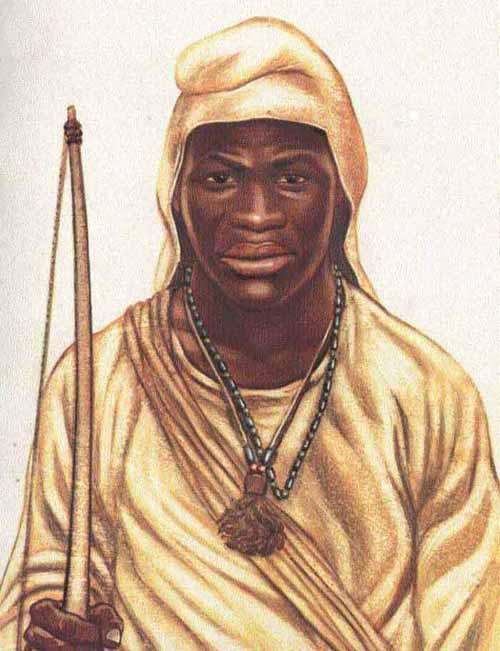
.jpg)