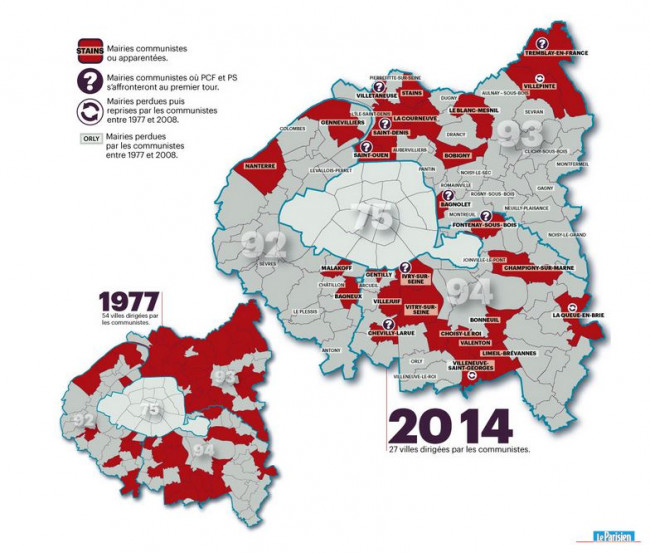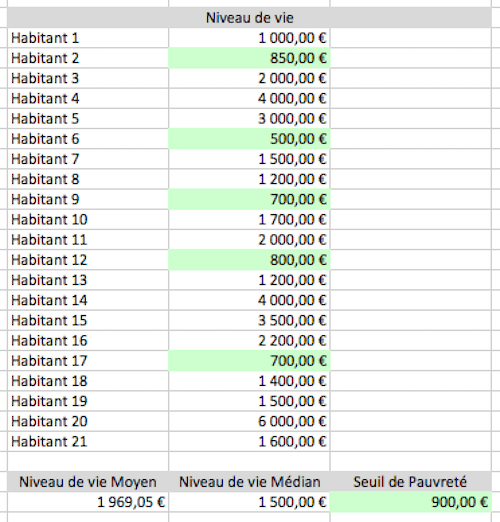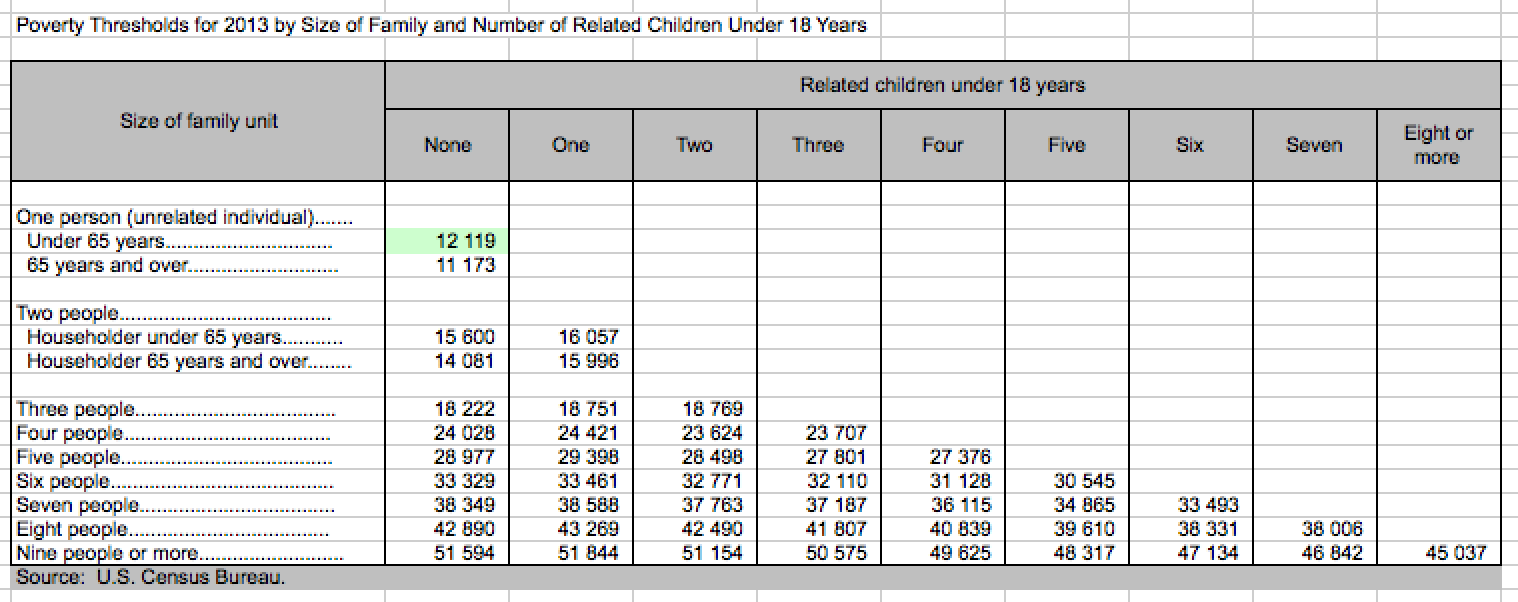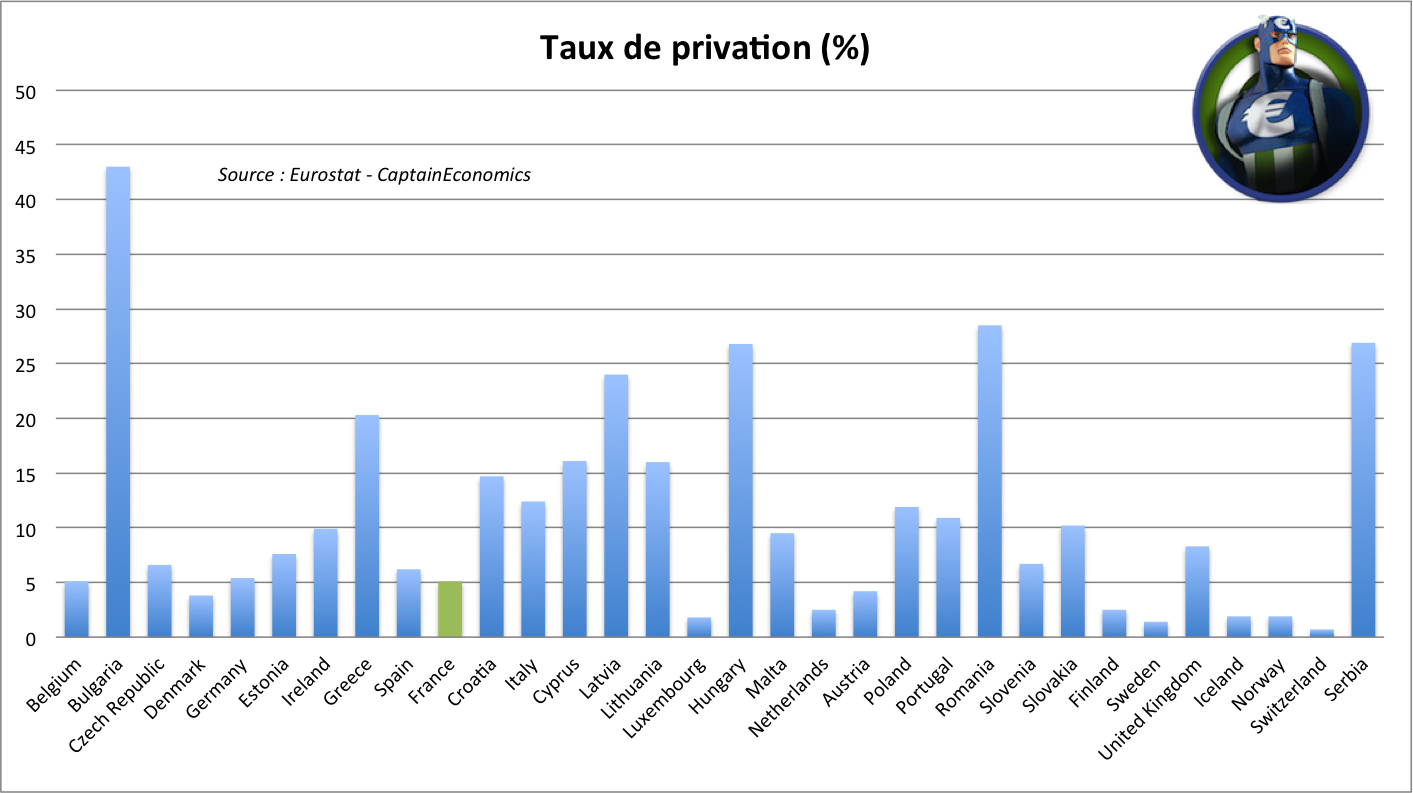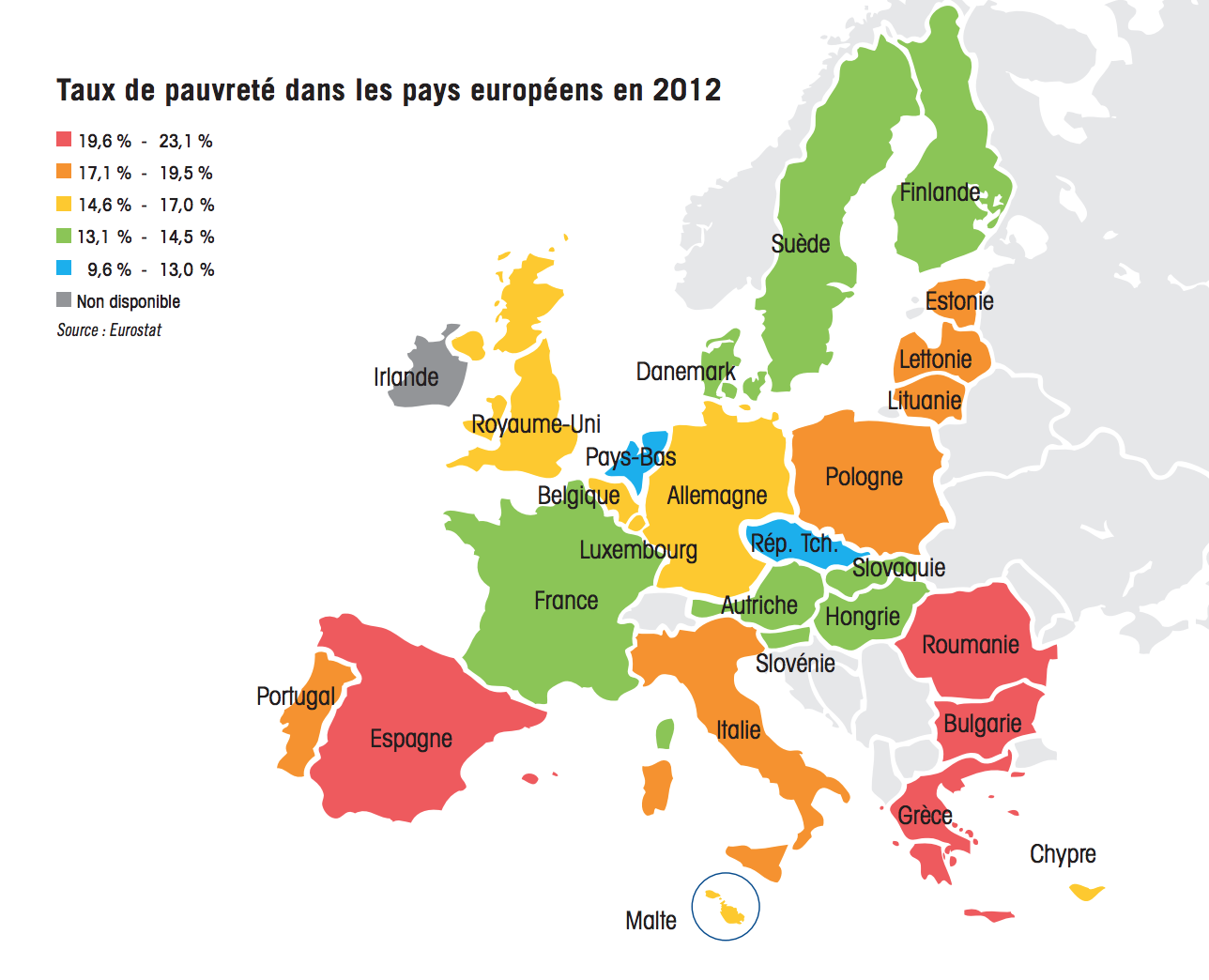1955, Elvis Presley lance le rock, les jeunes le suivent, les parents s’étranglent, les médias puritains rendent compte du phénomène en le fustigeant, la polémique s’empare du pays. Dix ans plus tard, après une carrière cinématographique matériellement bénéfique mais artistiquement désastreuse, Elvis, coaché par le colonel Parker, revient avec des bluettes pour le grand public. Trop tard : la magie est partie. En 1995, un feu follet de banlieue fait des singeries sur Radio Nova, puis Canal+ (1998). Il crève l’écran, à la télé et au cinéma. Vingt ans après, il fait toujours le singe, et la promo de l’idéologie dominante qui l’a fait roi. Des singes.
Postulat : tout phénomène populaire imprévu est désamorcé, contrôlé, puis retourné par le système, au cas où cet engouement deviendrait politique et se retournerait contre le système.

- En 1969, Michael Jackson ne plaisantait pas
Un petit voyage à travers le temps et l’espace permet de mettre à jour ce schéma récurrent. Imaginez, si après le succès de Thriller en 1982 (65 millions d’albums vendus dans le monde), Michael Jackson avait repris le discours critique des Black Panthers aux États-Unis… Imaginez Johnny, avant de fêter ses 70 ans et ses 50 ans de chansons, invité du 20 Heures de Claire Chazal en juin 2013, déclarer « ah que Jean-Marie c’est la solution, ouais ». Imaginez Jamel, l’idole officielle des jeunes de banlieue, faisant la fierté de tous ceux qui n’arrivent pas à obtenir respect et pouvoir, déclarer devant tous les micros qu’il faut voter Réconciliation nationale, le seul parti qui recolle une France en morceaux. Là, on n’est même plus dans le clash biodégradable du fonctionnaire amuseur Ruquier, le conflit permanent des hiérarques socialistes qui se bouffent le nez et l’argent public, le faux débat Joffrin/Guetta, les affrontements sous contrôle, non, on est dans le bordel thermonucléaire, l’incendie gigantesque et inextinguible des forêts de Californie, les journalistes qui s’étouffent, les patrons de médias qui s’apoplectisent, les gens qui se posent des questions. Qui doutent. Voilà pourquoi la star ne doit surtout pas poser de problèmes. Pour cela, elle ne doit pas être contrariée (fiscalement ou juridiquement), et on doit lui faire comprendre, en douceur, qu’il vaut mieux ne pas déconner avec son audience ou son capital sympathie, c’est-à-dire sa capacité de persuasion mais aussi de nuisance.

- Tel est pris qui croyait prendre
Jamel :
« Encore dernièrement, certaines personnes m’ont dit : “Je votais Jean-Marie Le Pen avant d’avoir vu vos sketches. Vous m’avez donné envie d’arrêter de voter Le Pen.” Là, quand tu rentres chez toi, tu peux arrêter ta carrière. Je continue encore un peu car je veux convaincre d’autres personnes. » (France Soir du 2 mai 2012)
Une minorité de puissances médiatiques ou de personnalités influentes utilise leur pouvoir pour la connaissance : si on ne peut accuser George Clooney de tourner dans des navets commerciaux, en revanche, lorsqu’il veut faire un film politique, les financements s’évaporent. C’est uniquement en acceptant de mettre son nom sur l’affiche qu’il pourra réaliser son Good Night and Good Lucken 2005, un huis clos éprouvant sur le maccarthysme, ce bref moment de visibilité de la dictature américaine. L’année du tournage, 2004, est aussi celle de la réélection de GW Bush. Clooney n’a pas été assassiné, son statut d’intouchable l’a protégé d’une campagne patriotique, mais aucune des sommités d’Hollywood n’osera aller plus loin, James Cameron mis à part, avec son Avatar. Une transposition à peine voilée de l’impérialisme américain et ses collateral damages. Mais ça reste consommable (15 millions d’entrées pour la seule France, et 107 pour les États-Unis, le pays le plus dépolitisé de la planète), et ça passe les barrages.
Le système libéral a ceci d’intelligent qu’il accepte une bonne dose d’autocritique, d’humour, et même de révolte. C’est ce qui fonde paradoxalement sa solidité par rapport aux régimes plus bêtement totalitaires. Le roseau démocratique et le chêne totalitaire, aurait dit La Fontaine. La sensation de liberté, due à ces espaces aménagés (et bien calculés) de possibles, suffit à contenir et dissoudre la majorité des colères et des désirs de changement ; ceux qui franchissent cette limite, qui s’attaquent donc à la structure et non plus à la superficialité du pouvoir, sentent le vent du boulet passer. Ce sont les crucifiés de la démocratie. Lenny Bruce, le modèle de Coluche (le Français sera plus facile à manipuler), mort d’une overdose de police selon Phil Spector (comme Coluche, d’après Antoine Casibolo, auteur d’une contre-enquête sur la mort du déconneur). Coluche dont le show comique virait dangereusement au meeting politique subversif, évolution que l’on reprochera à Dieudonné 30 ans plus tard. Coluche, ayant commencé, sous l’influence de ses mentors, dans le gauchisme grossier, dénué de toute dangerosité. C’est seulement quand il se tournera vers le poujadisme que les choses tourneront mal.

- Cohn-Bendit et Najman en 1968 : « Un pour tous, tous pourris ! »
Inutile de revenir sur le destin de Coluche, ou de tirer des plans sur la comète morte. Mais Coluche est l’exemple type de la personnalité populaire qui a immédiatement été prise sous couveuse du système. Son « amitié » avec Attali, sa proximité avec Goupil et Najman (qui soutiendra le communiste dissident Juquin, et qui sent l’agitateur patenté à plein nez), les agents trotskistes qui le rouleront dans la farine socialo-sioniste. Les cyniques diront : pas difficile d’embobiner des infatués aussi sous-cultivés.
Justement, prenons quelques unes des plus grandes stars du monde par le couplage des puissances financière et médiatique, Beyoncé, Dr Dre, Oprah Winfrey, Jay Z, Rihanna… Il reste, au tamis de la lucidité, une poignée de personnalités paralysées par leur image, obnubilées par l’argent (l’appât numéro un du système pour fermer les grandes gueules), un ego pathologique matérialisé par des armées de gardes du corps et d’assistants (un signe extérieur de richesse), des métabolismes chimiquement perturbés du matin au soir (la poire Mariah Carey et son vin blanc de bas étage servi par ses assistants dans des canettes de Sprite), au final des incultes bâtisseurs d’une image idéale grotesque, au mépris de toute vérité. Tout ça sans avoir jamais inventé l’eau chaude, ni la moindre molécule pouvant sauver une partie de l’humanité. Certes, les artistes sont nécessaires, mais leur placement au meilleur endroit de la vitrine du système a un sens : les modèles, ce sont eux, la connaissance passant au troisième plan, derrière l’argent et la gloire.

- Attention à la jamellisation des esprits !
« Il faut faire très attention aux discours qui tentent d’arrondir les angles. Marine Le Pen – je devrais dire Jean-Marine Le Pen – n’a pas changé, ses paroles sont dangereuses et font du mal à la France. Les gens qui y adhèrent sont fous. Je suis triste de devoir encore parler de cela. Je m’étais pourtant juré de ne pas le faire. »
Voilà pourquoi Jamel, « choisi » par le système (Bizot, de Greef et Lescure, ce trio d’américanophiles socialo-compatibles) il y a 20 ans pour donner une représentation et calmer le peuple des bannis (Arabes, Noirs et petits Blancs), demeure toujours aussi niais politiquement, plus encore depuis que les socialistes, toujours eux, le roulent dans la farine de l’humanisme coluchien, cette voiture-balai du libéralisme. Si toutes les stars qui arrivent au sommet tiennent le même discours, cela signifie qu’elles n’ont pas le choix.
Leur force de persuasion ne sera conservée que si elle sert le système. Autrement, la star en question dégringole ou dégage de la pyramide. On assiste rarement à une révolte de star, la frustration de réussite des années de vaches maigres poussant toujours vers les sunlights et l’enrichissement rapide. Rien de tel qu’un gros cachet pour se découvrir une responsabilité devant le grand public. Bigard, après ses premiers spectacles devant un tout petit Point Virgule, bouffant grâce à la générosité de la tenancière d’en face, se gavera des millions que le public lui adressera lors de ses années de gloire, s’étourdissant dans les excès (toujours les mêmes, pas la peine de faire la liste), et finissant lessivé… par un investissement hasardeux au cinéma et une censure médiatique, suite à une sortie anodine sur le 11 Septembre. Preuve qu’on peut facilement dire « bite couilles poil merde », plus difficilement les vrais gros mots que sont « attentat bidon », « impérialisme assassin » ou « boycott d’Israël », fort vexants pour l’axe américano-sioniste qui sévit chez nous.
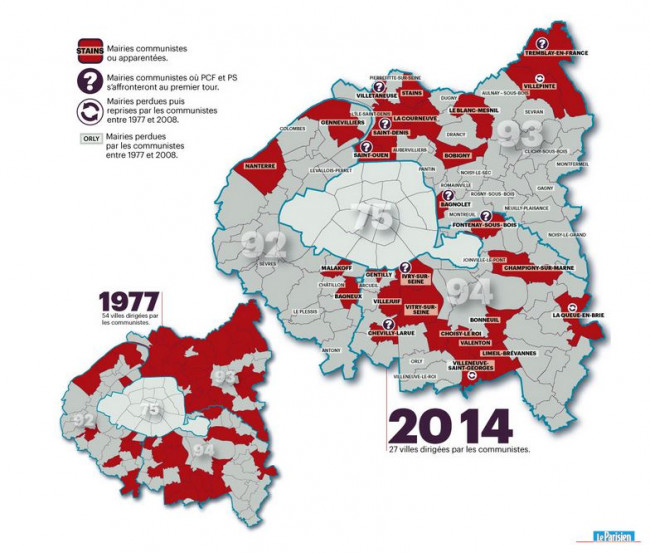
« Moi, j’ai une chance extraordinaire ; j’ai réussi à passer la barrière du périphérique et à me battre cœur et âme pour pouvoir exister. Je ne voulais être tributaire de personne et d’aucun système. Mais tout le monde n’a pas eu ma chance. »
Ne négligeons pas dans cette modeste étude l’ignorance (restons polis) et la vanité incalculable de ces demi-dieux, plongés dans un monde de surconsommation et de mensonges, que viennent ponctuer quelques éclairs de lucidité, de doute, et parfois, de tentative de suicide. Songeons à Madonna, médiocre artiste mais reine de l’épouvante, corps trafiqué et culture politique bloquée au stade infantile, qui dégoise sur Marine Le Pen. Il n’est donc pas forcément nécessaire de dépolitiser les analphabètes célèbres, ils le font très bien tout seuls. Le parcours de Jamel illustre ce phénomène : en gommant toutes les aspérités possibles (arabité, pauvreté, antisionisme), la machinerie du système a pondu un Jamel benettonien (prosélytisme du métissage), grand public (entreprise de rassurement des bourgeois), mondialiste (externaliser ses productions au Maghreb pour les avantages fiscaux), et infantilisant (régression de l’immigré au singe, en passant par le Marsupilami).
Jamellisation ou lepénisation des esprits, choisis ton camp, camarade !

« Je ne veux plus parler de ces personnes car en le faisant, je leur rends service. On nous fait peur avec ce spectre du Front national. Il est moins présent que ce qu’on nous dit. Je sais que la France n’est pas raciste ; je suis allé dans de très nombreuses villes, j’ai parlé avec beaucoup de Français. Ces gens qui essaient de nous monter les uns contre les autres le font uniquement pour exister, pour leur propre commerce, pour leur vitrine. Ne soyons pas dupes, je vous en supplie. »
Jamel, produit de grande consommation qui fait en contrepartie la retape de la propagande système. Certes, le Trappiste, longtemps conseillé par le pas très ami d’Israël Kader Aoun, essayera de s’extraire du showbiz, imitant en cela le modèle Dieudonné. Tentative de fuite qui n’aura qu’un temps. On connaît la suite. Aujourd’hui, Jamel est conseillé par sa femme Mélissa Theuriau, qui fait des documentaires archi corrects, elle commence même à jouer la comédie pour son mari (top crédibilité journalistique) ; les mauvais esprits (les djinns !) qui pouvaient influencer Jamel politiquement (Aoun, Zeghidour, présents lors d’un dîner Ardisson sur Paris Première le 26 janvier 2004) ont disparu des radars, remplacés par Bernard Zekri, l’ex-patron trotskiste de i>Télé devenu producteur de la star, et Raphaël Bennaroch, son manager. Si on osait, on dirait « y a pas de fumée sans feuj ». Mais c’est pas permis.

Dans le doc à lui tout seul consacré (5 ans avec Jamel), seul son frère Karim (producteur de Debjam) émerge de la structure qui pilote Jamel, et que Jamel pilote, allégeant ainsi son allégeance politique. En 10 ans, Jamel aura cédé à la tentation du diable dans le désert, passant de dieudonniste à chabatiste, puis à hollandiste, le fond du fond. Dans le deal gagnant-gagnant avec Hollande le Malin, Jamel a déjà perdu : une partie de son public, sa liberté artistique (les derniers qui ont fait ça pour Sarkozy en 2007 s’en mordent encore les doigts), et la totalité de son pouvoir de nuisance. Même s’il fait mine de croire le contraire :
« Je ne les lâcherai pas. Sur mon iPhone, j’ai mis en favoris Benoît Hamon, Aurélie Filippetti et François Hollande. Je les relancerai régulièrement avec un allié de poids, la fondation Culture et diversité de Marc Ladreit de Lacharrière. L’’improvisation théâtrale est un outil indispensable pour l’épanouissement des mômes. »
Soudain, un mini éclair de lucidité, vite réprimé :
« De voir ces énarques et ces gens érudits, qui ont les outils intellectuels et financiers à leur disposition, ne pas pouvoir régler les problème, je trouve cela incroyable. J’ai le sentiment que la politique ne fait pas suffisamment bien son travail, même s’il faut absolument croire en la politique. »
Un film de, sur, avec et pour Jamel Debbouze

Avant son film malencontreux, il lui restait encore quelques appuis médiatiques, tel Le Monde du 7 avril 2015, qui ose écrire des trucs du genre « la drôlerie irrésistible du verbe de Debbouze, alliage élastique et mutant de folie néologiste et de régression carapatée ». Plus sérieusement, la combinaison de la trahison de la subversion (pro-peuple) et du rapprochement avec les élites mène au rejet populaire. Sanction logique, mais incompréhensible pour l’intéressé. Plus le système mise sur lui, plus les gens s’en détournent. Les journalistes honnêtes sont obligés de suivre le mouvement : quand l’arnaque crève les yeux, qu’elle menace la crédibilité des journaux en charge des esprits, longtemps admiratifs du phénomène, ces derniers ne peuvent pas faire autre chose que de démolir, à mots choisis, la singerie :
« “Les intentions du réalisateur sont honorables. ’Pourquoi j’ai pas mangé mon père’ est une ode à la différence, et, dans ce décor préhistorique, Debbouze prône le respect de l’autre : handicapés, banlieusards, étrangers, femmes, Roms ou homosexuels. Dans une France qui fait des gargarismes de discours réacs, voir l’une de ses célébrités les plus populaires prendre le contre-pied total – et ce, sans aucune naïveté ou niaiserie – est évidemment très louable, voire franchement aimable”, écrit pour sa part Libération [C’est juste du business sur la cible la plus large possible, NDLR]. Les néologismes et les “sempiternelles approximations de langage” de Jamel Debbouze agacent également. “Le comique du film se résume à un salmigondis assourdissant de néologismes, jeux de mots ratés et borborygmes. ’C’est pour les enfants’, nous répondrait l’intéressé. Les enfants ne méritent pas ça”, tacle le journaliste de L’Obs. Au final, tous les critiques s’accordent sur une chose : ce film est au service de Jamel Debbouze. À travers l’histoire du roman original de Roy Lewis, l’humoriste retrace la sienne, endossant le rôle principal et dressant ainsi son autoportrait. “Mégalo, Jamel ?”, s’interroge Nicolas Schaller de L’Obs. “En donnant à ce petit personnage qui lui sert d’avatar le rôle de guide, conduisant son peuple hors de la nuit primitive vers la lumière de la civilisation, Jamel révèle en tout cas à ceux qui en doutaient que son ego, lui, n’est pas écrasé par grand-chose”, complète Le Monde. » (Autopsie d’un ratage, Le Figaro du 7 avril 2015)

Une mauvaise presse unanime… qui sauve ses fesses. Une analyse de l’échec relatif du long métrage de Jamel, qui avoue rétrospectivement 23 millions d’euros de budget, après avoir communiqué sur 35-40. Explication : avec 2,3 millions d’entrées, le film assure de justesse le retour sur investissement, exception faite des ventes à l’international. Les journalistes auront beau chercher des explications marketing ou artistiques, la gamelle était programmée, puisqu’en allant chercher le très grand public au mépris des particularités qui ont fait son succès, Jamel ne pouvait que se liquéfier. En le rendant soumis au système, donc inoffensif, Jamel a été tué. Au moment où plus rien ne semble lui résister.
(Les citations de Jamel sont extraites de son interview dans Le Monde du 15 juin 2014 .)